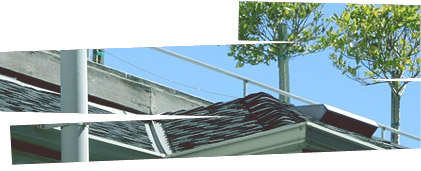CONCERTATION SUR LA RENOVATION DU REGLEMENT DU PLU
Contribution de l’Unsfa
Nos réflexions
1- Etablir des règles simples, compréhensibles par tous et évolutives.
La règle seule entraîne trop d’interprétation.
Adossée à un projet elle est encadrée et devient compréhensible.
Au risque d’aller vers trop de simplification, voire de déréglementation ne doit-on pas se poser à nouveau la question de mettre la règle au service du projet urbain, et non l’inverse comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui.
Peut-on envisager une réglementation simple, accessible, et évolutive au service du cadre de vie des citoyens.
Car il ne suffit pas seulement de respecter les règles ou d’appliquer des recettes pour concevoir la ville, ses espaces publics, son paysage, préparer l’accueil des équipements et des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.
Il faut d’abord la réfléchir et la « projeter », et c’est uniquement à partir de cette projection partagée que la règle pourra être établie.
Avant de la figer, la règle doit être évaluée, car elle impacte pour longtemps les projets architecturaux qui feront la ville.
Par son intangibilité, elle est redoutable, car elle ne peut être ni discutée, ni adaptée (ou vraiment à la marge), elle peut ainsi pour longtemps produire des effets néfaste sur la qualité urbaine.
Comme la règle d’urbanisme ne peut pas être adaptée, elle pèse beaucoup sur la conception des projets, beaucoup plus que toutes les autres contraintes réglementaires auxquelles sont soumises nos constructions.
La règle d’urbanisme est celle qui pèse le plus dans la conception du projet et par voie de conséquences sur la qualité de vie, la qualité de ville.
De ce fait la règle doit être aisément compréhensible pour bien l’intégrer à la conception des projets.
Et plus la règle sera simple et évidente, compréhensible par tous, plus elle confirmera son statut de garante de l’intérêt urbain collectif, et permettra d’accompagner l’intégration des projets.
Quelles que soient les règles urbaines édictées, rien n’arrêtera la créativité de l’architecte au service du projet.
C’est son métier de faire la synthèse de l’ensemble des contraintes pour établir le meilleur projet, au service d’une création architecturale garante de l’intérêt public.
Ainsi, considérant que la règle urbaine doit être au service d’un projet d’aménagement partagé et que la création architecturale est d’intérêt public, comment se fait-il aujourd’hui que l’urbanisme génère autant de tensions et de conflits.
Cela signifie, que la règle d’urbanisme ne protège pas, n’est pas garante de civilité, ni d’urbanité. Alors qu’elle devrait introduire le partage, elle porte en elle le germe du conflit.
Alors qu’elle devrait servir à la coproduction de la ville et faciliter la compréhension de sa construction, de son développement, elle sert à nourrir le contentieux. C’est tout le contraire de la « protection » qu’elle devrait apporter aux citoyens.
La règle, quelle qu’elle soit, n’a jamais empêché une architecture de qualité.
A contrario, elle n’est pas non plus garante d’un urbanisme de qualité, alors qu’elle devrait prioritairement être là pour ça.
Ceci démontre bien qu’il n’y a pas de lien réel entre la qualité architecturale et la règle. Mais qu’il y a un lien de dépendance directe entre la forme urbaine et la règle.
La règle d’urbanisme n’est pas faite pour imposer une architecture, mais pour projeter une ville partagée, où la notion de « bien vivre » devrait être la règle principale à mettre en œuvre pour le moindre m² de superficie à urbaniser ou à préserver.
2- Passer de l’urbanisme réglementaire à celui de projet.
Si la projection de la ville était partagée par le plus grand nombre, les conflits naissant de la règle n’existeraient plus car elle serait simplement appliquée car comprise et donc acceptée, et non pas interprétée et donc rejetée.
Le conflit nait plus volontiers de l’interprétation de la règle, que de son partage.
Ainsi la gouvernance du projet urbain aura un rôle important à jouer dans la mise en place d’un nouvel urbanisme réglementaire soucieux du bien être des habitants.
Il faut donc remettre la forme urbaine au cœur de la réflexion sur l’élaboration des documents d’urbanisme et arrêter de projeter la ville en zonage.
La ville en trois dimensions, la ville vue d’en bas, pour son habitant et son passant – la ville dynamique – à l’opposé de la ville cartographiée, la ville vue d’en haut – la ville statique.
En abordant la notion de la ville dynamique, en opposition à la ville statique, on ouvre des perspectives sur ce que devrait être une règle d’urbanisme partagée et en cohérence avec l’échelle du temps. Car il n’y a pas d’échelle de la ville sans prise en compte de l’échelle du temps.
3- Prendre en compte l’échelle du temps.
Sans la prise en compte de cette notion de durée, il ne peut y avoir de compréhension du fait urbain et donc des règles qui lui seront essentielles pour se développer harmonieusement.
Actuellement les procédures sont tellement longues pour élaborer les documents d’urbanisme qui vont contenir les règles d’urbanisme que l’on connait – car on ne veut surtout ne pas laisser de place à l’aléa, et tout sécuriser – que celles-ci sont presque obsolètes quand il faudra les opposer.
La vraie vie n’attend pas.
De ce fait le conflit peut également naître d’un souhait d’interpréter une règle qui n’est plus en phase avec la réalité et les nouvelles pratiques urbaines. Actuellement les définitions des règles applicables aux obligations de stationnement en sont un bon exemple.
Il faut donc que la règle soit assez souple pour permettre à la ville de s’adapter sans douleur et sans attendre.
L’échelle du temps pour construire n’est pas toujours compatible avec celui du temps pour penser et faire la ville. En dix mois on peut apprécier la réalité d’un équipement alors qu’il faudra attendre dix ans pour l’apprécier dans son contexte urbain final.
4- Bâtir durable par la coproduction et l’expérimentation.
Seule la ville plaisir, la ville désir peut s’inscrire dans la durée, et c’est sur ces notions de bien être partagé que doit s’appuyer la réflexion sur la rénovation du règlement du PLU.
C’est la réflexion sur la ville durable qui doit nous éclairer sur les nouvelles règles d’urbanisme à inventer, pour favoriser :
– La flexibilité et la réversibilité de l’habiter, au travers des programmes d’aménagement et de construction.
– La coproduction avec l’ensemble de la société civile, permettre une certaine perméabilité entre les acteurs de la ville.
Il faut arrêter de mettre la ville sous la toise en acceptant d’ouvrir le champ des possibles dans la règle urbaine, pour qu’elle ne soit plus intangible, mais comme la ville, évolutive car vivante.
C’est en considérant que la règle n’est pas un aboutissement mais un point de départ à partir duquel on peut discuter, échanger, faire accepter un projet, que l’on bâtira une ville partagée à travers un véritable registre de co-production au service des citoyens.
Certains pays européens sont déjà dans ce registre de coproduction de la ville, où le respect de règles minimales confirme le projet, tout comme l’adaptation des règles sur la base d’un projet négocié et concerté peut également être envisagé.
Il faut accepter que des porteurs de projets de qualité puissent contribuer à faire évoluer une réglementation qui ne peut avoir tout prévu, et qui est en décalage temporel avec les attentes de la société qui elle, n’attend pas que la règle soit écrite pour évoluer.
Ces expériences doivent pouvoir être éprouvées grâce à la concertation.
C’est pourquoi il doit-être favorisé la constitution de comités d’experts (architectes, urbanistes, paysagistes.) qui, le plus en amont possible d’un projet, peuvent accompagner les élus pour identifier et hiérarchiser les enjeux du territoire et définir les orientations à long terme pour son aménagement.
Ces comités pourront également être saisis dans le cadre de l’élaboration des projets par les différents acteurs afin de garantir le suivi entre le projet urbain envisagé et les réponses formelles qui le feront.
Ainsi le promoteur pourra s’assurer en amont que son projet architectural respecte les objectifs de PLU, et les élus pourront être éclairés sur la qualité du projet et de l’éventuelle plus-value qu’il apporte à la ville.
Nos propositions
1- Rendre obligatoire l’évaluation des documents d’urbanisme tous les cinq ans.
2- Sortir obligatoirement les zones à urbaniser qui ne le sont pas lors des évaluations.
3- Limiter les interdictions d’usage des sols afin de favoriser la mixité et la prise en compte d’opportunités au travers des projets non envisagés au moment de l’élaboration du PLU, mais utiles pour la collectivité ou la qualité du quartier.
4- Inciter à recourir à la procédure de « déclaration de projet », et la simplifier, pour rendre le document d’urbanisme vivant et évolutif.
5- Autoriser la densification de toute parcelle en zones urbaines par dérogation aux règles d’emprise et de gabarits, suite à une expertise des contextes de référence.
6- Supprimer les zonages en secteur rural et établir un véritable « projet » de développement communal en trois dimensions. La mise en place d’un véritable plan de composition architectural et paysagère à l’échelle de la commune.
7- Favoriser la reconstruction de la ville sur la ville en faisant émerger des plans de (re)composition urbaine (esquisse d’aménagement détaillée remplaçant les trop succinctes orientations d’aménagement) et permettant l’abandon des règles concernant l’aspect des bâtiments, sujettes à trop d’interprétations.
8- Eriger la « couture » urbaine en dogme. Travailler sur l’îlot et non la parcelle, permettre les échanges de droits à construire à l’échelle des quartiers pour optimiser la densité, la forme urbaine et la qualité architecturale.
9- Présenter les règles de gabarit et de densité sous forme de dessins en trois dimensions permettant de définir les formes urbaines, et les conséquences liées à ces choix.
10- En dehors des secteurs protégés et sauvegardés, et pour les projets portés par les architectes n’introduire aucune imposition de matériaux pouvant impacter la forme et l’aspect des bâtiments, afin de laisser plus de liberté à la création architecturale et à l’innovation qui sont toujours en avance sur le temps de la politique de la ville.
11- Accompagner les élus sur la prise en compte de la qualité architecturale par la mise en place de comité d’experts les accompagnants dans la mise en place de leur politique urbaine et dans l’analyse architecturale des demandes d’urbanisme.
12- Inciter et favoriser à travers les documents d’urbanisme, l’expérimentation et l’émergence de nouvelles formes urbaines au service de la mixité et du bien vivre ensemble.
13- Ne plus rendre opposable règles concernant l’aspect des bâtiments dès lors que les projets sont portés par des architectes ou que les projets sont validés en amont par des comités d’experts.
14- Favoriser des règles de gabarits simples dont le strict respect emportera systématiquement l’accord sur l’autorisation d’urbanisme déposée et portée par un architecte, mais en parallèle permettre l’introduction d’adaptations librement négociées avec un comité d’expert et d’usagers, permettant d’améliorer l’intégration urbaine du projet au regard de la qualité du site.
15- Inciter les communes à définir des périmètres de haute qualité environnementale urbaine et paysagère à l’intérieur desquels le recours à l’architecte est obligatoire dès le premier mètre carré. Etendre cette disposition aux AVAP, abords et secteurs protégés.
Pour l’Unsfa, le 04 mars 2015